Bienvenue dans le bar de Galactus : chaque lundi, une nouvelle page est à votre disposition pour discuter cinéma, télévision et comics au sens large, loin des univers Marvel et DC Comics !
Une franchise qui avance dans le temps au lieu de multiplier les préquelles à l’infini ? Il va pleuvoir ! La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume sort mercredi sur nos écrans, et c’est donc Wes Ball (Le Labyrinthe) qui succède à Matt Reeves (The Batman) derrière la caméra. Devant, nous retrouverons l’une des stars de The Witcher, Freya Allan, qui décroche ainsi son premier rôle dans un blockbuster. Le même jour, Ryan Reynolds se fera un peu d’argent de poche – en attendant Deadpool & Wolverine – avec la comédie familiale Blue & Compagnie, qui est tout de même réalisée par John ‘Mr. Fantastic’ Krasinski. Enfin, nous avons bien sûr une pensée pour Bernard Hill, qui est mort à l’âge de 79 ans. Il était le capitaine du Titanic et le roi Theoden dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux, soit l’âme d’une des scènes les plus épiques de l’histoire du cinéma. Alors, debout ! Debout commentateurs des Toiles Héroïques ! Les claviers seront secouées, les touches voleront en éclats lors de cette semaine de la plume, une semaine rouge avant que le soleil ne se lève !
Plusieurs générations après le règne de César, les singes ont définitivement pris le pouvoir. Les humains, quant à eux, ont régressé à l’état sauvage et vivent en retrait. Alors qu’un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire, un jeune singe entreprend un périlleux voyage qui l’amènera à questionner tout ce qu’il sait du passé et à faire des choix qui définiront l’avenir des singes et des humains…



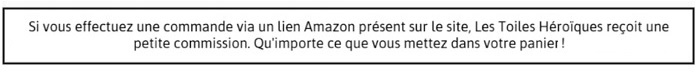



RIP Bernard Hill, nul doute que des fleurs blanches pousseront là où il repose.
Très hâte pour ce Planète des Singes !
« No parent should ever have to bury their child ». Une des scènes les plus poignantes du Seigneur des Anneaux.
« Une franchise qui avance dans le temps au lieu de multiplier les préquelles à l’infini ? »
J’attenderais quand même avant de sabrer le champagne, parce qu’il as quand même un belle tête de prequel a l’original malgré tout 😅
Sans oubliez le retour du Docteur ce vendredi sur Disney+. Pour la Planète des Singes n’ayant pas vu la saga, je vais me faire un marathon des films (du moins les plus récents), que je puissent cochez cet case dans la catégorie Film de SF à voir.
Deaaaaaattttthhhhhhhhhh !!
For Eorlingas
RIP King Theoden
Je dois rattraper « Challengers » au cinéma, j’ai pu voir « Civil War » qui m’a bien chamboulé. Je n’arrive pas à me décider si l’absence de contexte est un point fort ou faible du film… Sinon c’était clairement une expérience qui m’a sorti de ma zone de confort, la dernière demi-heure est très rude. Dans mon Top 2024 sans hésitation !
Bref, tout ça pour dire que le nouveau « Planète des Singes » sera ma prio au cinéma cette semaine ou la prochaine.
J’ai revu la trilogie « Le Hobbit », pour la première fois en 4K, je ne sais pas si c’est le format ou moi mais j’ai trouvé le premier film (et le troisième) vraiment exceptionnels, bien meilleurs que dans mes souvenirs. Avec suffisamment de rythme et d’épique pour être happé, et qu’est-ce que c’est beau (alors que j’avais le souvenir de CGI dégueulasses, peut-être que c’est lié à mon bon set-up). Bizarrement, le second opus était mon favori et, finalement, je trouve que c’est le moins bon.
Fin de semaine j’enchaîne avec le marathon 4K du Seigneur des Anneaux ^^
Ça dépend de son état lors de son visionnage ou cela veut dire qu’on vieillit ^^
Lors de mon précédent visionnage du Seigneur des anneaux, j’ai préféré la communauté des anneaux sur les deux tours alors qu’au cinéma, les deux tours avait eu ma préfèrence.
un premier semestre avec Dune part II, Planet of the Apes et Furiosa laisse quand même à penser que 2024 sera une rudement belle année …
« Debout commentateurs des Toiles Héroïques ! Les claviers seront secouées, les touches voleront en éclats lors de cette semaine de la plume, une semaine rouge avant que le soleil ne se lève ! »
Merci pour ce beau passage Monsieur Lth
Comment je t’ai grillé, je sais qui tu es !
Alors vas aider ta mère !!! 🙂 🙂 🙂 sinon j’appelle Bernard…
FORTH EORLINGAS!
6 mai 2024 at 12 h 00 min
Espérons que cet opus ne s’éparpillera pas, comme le troisième volet de Matt Reeves, qui a loupé de peu d’être un grand chef d’œuvre – mais vraiment de très peu.
Enfin, un nouveau Roi va peut-être émerger chez les singes, un autre est mort (RIP), et un roi de la bonne humeur fait mumuse avec des Muppets en CGI.
Vu :
– « La Brune de mes rêves »…
Comédie de Elliott Nugent, dans laquelle Bob Hope se rêve détective privé à la Bogart, alors qu’il est une catastrophe ambulante, plus interressé par les bons côtés : draguer les belles clientes.
Beaucoup de gags rigolos, des cameos sympas.
_
– « La Bonne Combine »…
Edmund Goulding réalise un faux polar à la gloire des agents gouvernementaux, aux trousses de divers faussaires, avec un aspect très documenté etc – Anthony Mann en a fait quelques-uns.
Il s’éloigne très vite de ce programme, pour se concentrer un peu trop sur une romance naïve et idéaliste – charmante Dorothy McGuire, et un Burt Lancaster plus humble qu’à l’accoutumée…
Car le malfrat à épingler n’est autre que le Mr Kringle du « Miracle de la 34e rue », Edmund Gwenn. Un papy qui se présente comme un Père Noël à l’envers, vétéran de guerre, réellement inoffensif et personnage à la Capra qui répond toujours franchement quand on l’interroge (encore faut-il daigner lui poser des questions)… en bref, dont la liberté dérange alors qu’il ne se rend coupable que de microscopiques usages de fausse monnaie, juste pour vivoter dans son coin.
Il est alors temps de découvrir si la Justice est capable de rendre un jugement qui ne soit pas implacable, et de s’adapter aux cas particuliers. Ce qui assez audacieux dans une film si respectueux d’une institution judiciaire.
_
– Début de l’intégrale Yves Robert…
_
– « Borgo »… Analyse complète au Bar #249.
Il n’y a peut-être pas de hasard à ce qu’il y ait quelques correspondances entre le précédent film de Stéphane Demoustier « La Jeune fille au bracelet », et « Stillwater » de Tom McCarthy (basés sur un même fait divers, où une jeune femme aurait tué sa meilleure amie), et qu’on se dirige ensuite vers un « Borgo » qui va par contre nous faire vivre en détail les faits.
De sorte que lorsqu’on se retrouve à la fin, avec les policiers qui interrogent (et qui ne sortent pas de nulle part puisque eux aussi, on les a suivi)… Tout nous ramène à l’histoire de ce couple dans le film, au mal qu’ils se sont indirectement fait, et à la nécessité de faire bloc et se couvrir mutuellement pour sauver leur foyer – et peut-être leur amour… sans une seule fois s’être concertés au préalable. Quitte à être ouvertement malhonnêtes (pour nous, spectateurs).
Mais la dernière scène des films de Demoustier et McCarthy restera toujours pleine d’ambiguïté :
Pourquoi se mettre un nouveau bracelet à la cheville ? Habitude ? Symbole de culpabilité ou de liberté ?
Que voit Bill depuis son perron ? La vérité trop moche à supporter ? L’acceptation de celle-ci ? Ou bien la beauté tout autour ?
Le vélo de la fille de Melissa ? Avec l’argent encore dedans, histoire d’avoir une petite assurance ? Va-t-il quand-même passer la douane ? Ou bien plus rien dans le vélo, car c’est l’argent du Crime et mieux vaut une vie calme et modeste ?
Ce sont vraiment de très bons films…
_
– « Villa Caprice »…
Bernard Stora n’a pas fait énormément de films dans sa carrière, avec surtout des scénarios et de la télé.
Dommage que ce long-métrage, assez inspiré d’un fait divers aussi torturé que pathétique, n’ait pas d’énormes qualités cinématographiques. Niels Arestrup y est un personnage particulièrement fort dans son métier (d’avocat), mais qui n’est qu’un colosse aux pieds d’argile, tombant dans un piège contre lequel il ne va trouver aucune parade.
Une chute plus triste qu’implacable – il reste le personnage le plus sympathique au milieu d’une galerie de faux culs arrogants. La fin est trop abrupte pour qu’on soit touché, dans un film qui ne sait pas générer une quelconque empathie.
_
– « Shooter, tireur d’élite »…
Antoine Fuqua nous refait »JFK » et « Le Fugitif » en un, en imaginant ce qui se passerait si Lee Harvey Oswald était un super pro à la Steven Seagal… donc il ne risque rien, il est trop fort – un peu moins surhumain, un peu plus expressif. Ses méthodes pour rendre la justice face à des salauds corrompus et braillards, avec un faire valoir gentil et des personnages féminins très mal écrits… tout ça, c’est vraiment du Steven ! Du genre à poser des problématiques (le sort des vétérans et des familles en deuil, l’amertume face aux limites de la Justice), et à tout régler de façon bourrine, avec une confrontation entre deux hélicos qui fait lointainement penser à « Deux Hommes en fuite » de Losey…
Même Mark Wahlberg n’y peut rien – le reste du casting encore moins.
Mais bon avec Fuqua, ça passe.
_
– « The Gang »…
Réalisé par André van Duren, un film d’époque polardeux qui lorgne un peu du côté du « Black Book » de Verhoeven. On y retrouve d’ailleurs Matthias Schoenaerts, laissant croire que ce sera lui le personnage principal, repenti sorti de prison, espérant une vie honnête avec sa compagne malgré la tentation…
Mais non, c’est bien sur elle que le film repose (un peu trop), jouée par Sylvia Hoeks, femme libre mais encore bien trop écrasée par une emprise machiste, dans un Pays-Bas pré-fascisme (la ville de Oss, déjà prise en étau entre la mafia locale et des élites corrompus).
Pas grand chose à raconter dans cette intrigue proche du soap opéra (les liens intimes entre tous) : inéluctablement les salauds vont tomber, les héros seront rares et peu efficaces, et elle seule sera rescapée malgré le peu d’empathie qu’elle génère.
_
– « Si on chantait »
Le film de Fabrice Maruca connaît la musique : l’usine, les prolos, une économie originale pour s’en sortir (oui enfin commander une chanson, les américains le faisaient déjà depuis, Pouf…).
Dans ce genre de film il n’y rien d’étonnant à ce que Alice Pol joue toujours la belle fille qui fait les mauvais choix, Clovis Cornillac en ringard – costard – contre-emploi, Artus en rigolo fils à maman…
Par contre Jérémy Lopez en héros principal, ça n’est pas une recrue bien enthousiasmante. Surtout si c’est pour finir avec des bons sentiments à l’arrivée, incluant un faux rebondissement (l’explosion du groupe) en cours de route – c’est un peu artificiel.
Film pour jeunes enfants et public calme.
_
– « Kung Fu Yoga »…
Stanley Tong retrouve son jumeau (sauf pour l’année deo naissance) Jackie Chan, pour une coproduction Sino-Indienne en forme de fourre-tout.. du Indiana Jones avec des arts martiaux, du jeu vidéo (le prologue !), du Toc, du cartoon (plein d’animaux en CGI), et même du Michael Bay avec une course-poursuite en voitures à Dubaï, incluant un lion qui dégueule et s’appelle lui aussi Jackie…
Et ça finit en danse Bollywoodienne.
Si vous avez compris comment s’enchaînent les arrivées des personnages à chaque début de séquence, vous avez bien de la chance.
Sinon, prenez juste du plaisir avec les scènes d’action, au moins le contrat est rempli.
_
– « La Traversée »…
Le réalisateur Varante Soudjian est un habitué des comédies bien décalées, flirtant beaucoup avec l’inconfort et le danger… On aurait pu croire qu’il se la jouerait plus classique et plein de bons sentiments avec ce nouvel opus très programmatique : des jeunes de banlieue Wesh gros !, leurs éducateurs essayant de les canaliser pour qu’ils évitent les problèmes, de la drague au menu, de la chanson vintage (Gilbert Montagné), la Nature autour de vous et la tolérance, et un chauffeur mal embouché…
Mais c’est ce dernier qui va être le personnage pivot du récit, et bien plus encore.
Joué par l’acteur fétiche de Soudjian, Alban Ivanov, dans son rôle de prédilection de doux dingue un peu faf, ici en mode capitaine de navire (un voilier)… mais pas de pacotille comme le McCallister des Simpson, par exemple.
Plutôt comme un Haddock, bien barbu, vraiment professionnel, pas commode… on remplace juste l’alcoolisme et les vociférations grotesques par une obsession du contrôle et des piques assassines.
Pas bien tolérant le gars, ex flic, vite regardé de travers. Mais il a toute une histoire quasi tragique derrière lui, très crédible (on a l’impression d’être dans la suite de « BAC Nord), et Ivanov l’interprète avec un ton qu’on ne lui connaissait pas : tout en sobriété, stoïque, mâchoires à demi serrées, et regards intenses. Un gars viril à l’ancienne qui sait ce qu’il fait, fait ce qu’il dit, dit ce qu’il pense sans pipeauter… c’est Clint Eastwood qu’il joue, littéralement ! Avec de la calvitie et de l’embonpoint certes, et ça n’est pas bon plus un « Maître de guerre » sur l’eau… mais on n’en est pas loin.
Pas du tout bouffonesque cette fois. Toujours drôle, mais d’une autre manière.
Bien entendu à mi-film il va s’ouvrir à ces jeunes en difficulté, dont certains ont eux-mêmes un historique pas bien gai… Et ça passe. Avec une justesse incroyable !
Déjà parce que les jeunes acteurs sont tous bons, tous touchants – surtout les filles et le plus grand, les deux glandeurs étant un peu plus relégués à des rôles de faire-valoirs comiques, à égalité avec l’éducateur joué par Lucien Jean-Baptiste – à part une petite poignée de scènes, lui sera ridicule et pathétique du début à la fin, mais sans desservir le film (on dirait vraiment du Martin Lawrence – normal, c’est sa VF).
Ivanov est l’acteur principal, c’est donc sans problème qu’il éclipse Jean-Baptiste ainsi que la tonique Audrey Pirault (un peu moins, elle), jusqu’à une scène de sauvetage en mer qui a l’audace de se passer après une série de séquences bienveillantes (l’acceptation du corps, les dauphins) ou résilientes (l’expérience idéale qu’on se résigne à laisser tomber)…
Puis, osant créer une rupture de ton réellement traumatisante, dont la résolution a été parfaitement construite au préalable :
Non il ne s’agira pas d’une histoire où on va se reconstruire uniquement avec de la franche camaraderie et un peu de mentorat, bref que avec des bons sentiments. Car la violence à laquelle on voulait échapper peut toujours frapper, à n’importe quel moment. Et ça aussi c’est quelque chose auquel il faudra se confronter, jusqu’à craquer (là c’est plus Eastwood, c’est Ed Harris dans « Abyss »), remettre en cause tout ce qu’on sait, et mieux exorciser ce mal qui vous ronge.
Et enfin arriver à bon port, en étant moins bête et plus serein qu’avant.
Définitivement le meilleur film de Varante Soudjian, qui a ainsi offert son meilleur rôle à Alban Ivanov…
Définitivement un sacré acteur.
_
Lu :
– Deuxième Intégrale des Tortues Ninja modernes, par Kevin Eastman, Tom Waltz et plusieurs dessinateurs…
Attention, à ne pas lire en une fois (même si ça se parcourt très vite) mais un arc narratif après l’autre : quelques histoires intimes, puis un remake des Krangs et du Fugitoïde (avec de drôles de rescapés de Zelda), et enfin un récit qui remonte le temps jusqu’à la malédiction qui a donné naissance à Shredder.
Scénaristiquement plus abouti que les Tortues d’antan, mais on y perd sacrément en mise en scène.
– Sillage tome 19…
Un tome de transition pour la série de Morvan et Buchet, dont on ne comprend pas le but individuel : jouer sur le Temps, avec un faux effet Rashōmon (tous les points de vue exposés sont factuels) ? Raconter une histoire d’amour ? Une histoire de génocide ?
Ce n’est pas très abouti.
– Premier tome de Arrowsmith…
Un album qui a tous les atours d’un film, avec le parcours typique d’un jeune idéaliste face à l’horreur de la Guerre (la Première, Mondiale) alors que tout meurt autour de lui. Et que une once d’amour charnel sera un bref réconfort.
Avec donc l’originalité d’un univers de Heroic Fantasy, qui aurait perduré grâce à de mystifiants accords pris par d’anciens rois – le descriptif dans les pages bonus est assez touffu, dur à intégrer complètement, on se croirait chez Alain Moore.
Classique pour Kurt Busiek, et bien mis en scène par feu Carlos Pacheco.
– Avant dernier tome de Tony Chu…
Layman et Guillory ont déjà la tête dans le futur (de certains de leurs personnages), mais jouent éhontement au coup de la fausse mort annoncée… Jusqu’à un final qui était bien prévisible.
C’est reculer pour mieux sauter à l’ultime tome.
– Troisième tome de The Magic Order
La méthode Mark Millar : attirer des stars du dessin avec de bons royalties, la garantie d’avoir un arc narratif complet à dessiner… et derrière, un scénario qui rebondit artificiellement et n’a aucun recul – sûrement écrit au fur et à mesure, sans revenir en arrière pour faire des corrections et mieux construire les revirements de situation.
Mais là, c’est une portion d’histoire. Qui finit sur un suspense.
9 mai 2024 at 12 h 02 min
Planet of the Agence Protectrice de l’Environnement ?
Et en préambule, établissons que chaque nouveau film de « La Planète des Singes » s’apparente à un miracle cinématographique : mettre de gros moyens techniques et numériques dans un divertissement sombre et pas du tout clinquant, parlant de communautarisme, de xénophobie, de combat pour les droits civiques, de spécisme, d’écologie, de collapsologie…
Au temps pour tous ceux qui se plaignent que les grosses fictions modernes veuillent nous « imposer » des messages, des idées… puisque dès les années 60-70, c’était déjà le cas. Et ça ne gênait pas grand monde « en ce bon vieux temps ».
Risque calculé toutefois, car il s’agit aussi là d’une marque, une franchise très célèbre et culte.
Plus risqué était le projet initial du réalisateur Wes Ball, une adaptation en action réelle et mocap de la Bande-dessinée Mouse Guard/Légende de la Garde… comment faire accepter aux spectateurs un récit d’Heroic Fantasy (genre qui reste très rare sur grand écran, occulté par « LOTR »), avec de petites souris qu’on peut difficilement anthropomorphiser, sous peine de récolter un rendu trop bizarre ? Normal que Disney n’ait pas hésité à mettre ce projet sur la liste de ceux à annuler, au moment de leur reprise en main du studio 20th Century (Fox).
Brillant choix de consolation (et très fair-play), la nomination de Ball à la tête d’une nouvelle Saga Planète des Singes, faisant suite à une trilogie récente incroyable, reboot des films originaux – et pas prequels, car les suites des 70’s l’étaient déjà.
Une histoire complète, des épisodes ambitieux et conçus sans pression, un héros formidable à l’évolution tragique… Et mine de rien, une couleur très identifiable pour chacun, comme si on y racontait une saison différente à chaque fois : estivale pour le premier de Rupert Wyatt (reproduisant plus ou moins les couleurs chaudes du chef-d’œuvre de Franklin Schaffner), automnale pour le deuxième par Matt Reeves (brun et gris), hivernale pour le dernier de Reeves et de Andy Serkis (gris, noir et neigeux).
Ici la couleur serait plus printanière (verte et claire), idéale pour un nouveau départ. Commençant par un prologue qui fait directement suite au précédent film « …Suprématie », on pose ici les bases de ce que cette histoire va raconter : quel héritage laissé par César ? Où en sont singes et humains, jadis symboliquement réunis via une petite fille ?
Le résultat est une immersion dans une tribu de fauconniers, qui met une triple claque aux Na’vis trop élégants, trop americanisés sur leur planète bien propre et trop peu sauvage. Le scénariste Josh Friedman (entre autre) a travaillé sur le dernier film « Avatar », et évite de trop bégayer, même si le script repose sur beaucoup de moments typiques… de jeunes chasseurs, un rituel pour passer à l’âge adulte, la présence d’un animal rétif au domptage, l’honneur d’un père, l’invasion du foyer, et de petites séquences du quotidien où il ne se passe pas grand chose. Juste pour prendre le temps de découvrir ce monde alors que le nouveau héros, Noa, va devoir entamer un voyage risqué et, bien évidemment, initiatique.
Un peu comme une version, en moins violente, de « Apocalypto ». Beaucoup comme une reprise de l’intrigue du troisième film, la quête de vengeance en moins.
On passe alors une première heure fascinante, à évoluer dans un environnement totalement sens dessus dessous, où ce n’est pas juste le Monde qui a été recouvert par la végétation… C’est la Nature qui a repris ses droits, et le Monde des humains d’être réduit à des groupes faibles et primitifs, et une poignée de souvenirs architecturaux dont on se plaît à identifier les silhouettes, retraçant une sorte de parcours à travers des Etats Unis fantomatiques – bien mieux que « Civil War ».
Toute cette moitié du film brasse bien des thèmes intéressants, que ce soit le pouvoir de la connaissance, des noms qu’on fait perdurer avec le temps, de l’interprétation des mythes et des religions qui peut amener à l’émergence de dictatures… Il y a un côté Antique là dedans, voire même Biblique avec l’inclusion dans l’histoire d’un vieux sage, puis d’une sorte de Muse, et avec un personnage central du nom de Noa… donc comme Noé, d’autant que l’Eau va avoir une importance particulière (certains éléments scénaristiques empruntent aussi bien à la version de Tim Burton qu’au film de 1968 et à « La Bataille de la Planète des Singes »).
Beau à pleurer, avec plus de scènes d’action que de réflexions politiques. Et maintenant, au moins 95 % de singes à l’écran, ce qui nous permet d’admirer à nouveau le travail des techniciens de Weta Digital, les textures des individus, une harmonisation inouïe entre réel et numérique, au service de personnages intégralement touchants. C’est toujours réussi car c’est concentré sur l’essentiel, sans en rajouter – c’est pas un divertissement super-héroïque rigolo, ne pas confondre.
On en vient à croire qu’on va assister tout du long à un grand film d’aventure classique (toujours grandement inspiré du Western), avec très peu de second degré, célébrant la force des liens entre gens pourtant très différents…
Mais au détour d’une scène aquatique (justement), où un sacrifice passe pour une promesse, là on va bien se rappeller où nous nous trouvons :
C’est la franchise « La Planète des Singes » ! On y parle toujours de nos propres conflits ancestraux par le biais de la Fiction. Ça ne va donc pas se passer de façon optimiste, la noirceur et l’amertume prennent souvent le pas sur la sagesse, et il y a des failles qui semblent en fin de compte impossible à combler.
On arrive face à un antagoniste cupide et populiste, similaire au Roi Louie du « Livre de la Jungle » (mais en bonobo, plutôt macho séducteur). Il a beau faire de la récupération idéologique, déformant le discours de César tout en assénant des vérités dérangeantes, ce vilain reste un peu trop grande gueule – normal, c’est Kevin Durand qui le joue.
On a droit aussi à la sempiternelle vieille ganache, qu’on voit dans chaque films de cette Saga (c’est William H. Macy qui s’y colle, sans trop se forcer)… et la perception du récit change étrangement à ce moment là, l’évolution de l’histoire est le signe que quelque chose de probablement plus dangereux se trame derrière.
Alors, quand on se retrouve également avec des bunkers mystérieux, de la technologie perdue, des mensonges, des volte-face et une héroïne mi-Ève mi-Lilith… mais c’est bien sûr, Wes Ball nous remake aussi ses films du « Labyrinthe ». Ce qui n’est pas une mauvaise référence, cette trilogie étant l’un des hauts du panier dans le genre Science Fiction-Young Adult.
Ces thématiques chères au réalisateur s’intègrent finalement bien à « La Planète… », même s’il faudra peut-être un temps d’adaptation pour s’y faire, puisque cette fois les divers volets devraient être planifiés avec beaucoup d’avance.
Certes ce film a quand-même droit à une vraie conclusion, ouf !… Mais il laisse aussi quelques éléments intrigants en suspens (verra-t-on bientôt des astronautes ? et pendant qu’on y est, ira-t-on un jour sur la Côte Est ?).
Et comme dans un Young Adult c’est la jeune fille (indomptable Freya Allan) qui finit par éclipser tout le monde – facile dans une série de films où les humains ont toujours été sous-écrits, à quelques exceptions près.
Un peu aussi détriment de l’interprète de Noa, Owen Teague. Mais c’est normal, l’acteur n’est pas Andy Serkis (ses grands rôles, ses yeux et sa gueule très reconnaissables)… Il débute en rôle principal, mais son personnage gagne en assurance et en pragmatisme, au fur et à mesure qu’il devient un guerrier malgré lui, moins naïf et plus rude (que valent les lois de César quand il faut protéger sa vie ?)… Suffisamment pour qu’on puisse fonder de grands espoirs sur lui.
Tout comme pour l’évolution de cette nouvelle suite de films, aussi épique que prometteuse… Mais qui n’hésite jamais à nous rappeler ce que c’est que deux cultures violemment irréconciliables, chacune ne se résignant pas à être dominée par l’autre.
À moins que peut-être, un jour…
Il suffira d’un singe
Un matin
…
C’est écrit dans nos livres
En latin
6 juin 2024 at 12 h 01 min
Da ba dee da ba di…
L’acteur John Krasinski est passé à la mise en scène aux alentours de son accession au rôle de père, dans sa vie privée… Et en voyant quels thèmes il brasse dans ses films, on ne peut que se demander si l’auteur n’a pas des craintes pour sa jeune famille, pour ce qu’il va leur laisser, et s’ils sauront se débrouiller sans lui.
Après « La Famille Hollar », son opus suivant a été « Sans un bruit », qui se passait déjà avec des créatures invasives, une famille frappée par le deuil et encore en sursis… et sa suite était assez similaire, enfonçant le clou au bénéfice de la fille ainée de l’histoire, vraie héroïne/élue principale.
Comment se renouveler ensuite, tout en restant fidèle à ses obsessions ? Simple : en renversant complètement le contexte.
À l’un la vision sombre d’un Monde (assez bien construit, codifié, foisonnant) où les pères autoritaires échouent dans leur tâche, laissant le pouvoir à des femmes plus coriaces…
À l’autre la vision optimiste d’un Monde (simplifié, peu codifié, très familier) où les mères sont absentes, les grands-mères larguées, et aux hommes de devenir des êtres plus sensibles.
Du film d’horreur et d’action apocalyptique, jouant sur le contrôle du Son, à la comédie enfantine, reposant sur ce qui est Visible ou hors-champ… Tout ça avec une maîtrise imparfaite mais, a priori, beaucoup de sincérité.
Toutefois, ce qui alourdit un peu ce « Blue et cie », c’est sa façon de puiser dans une multitude de références connues, pour mieux les agglomérer dans un Tout cohérent. Et ça a beau être un film Paramount, Krasinski semble surtout avoir pioché l’inspiration dans une grande partie du catalogue Disney, incluant les studios dont ils sont propriétaires (même récemment)…
Vous y retrouverez facilement des idées sorties d’un Fincher ou Shyamalan (prévisible), ou un mélange réel/animation cartoon aussi fluide qu’un « …Roger Rabbit ».
Et une grosse, grosse partie des thématiques Pixariennes, ce qui en fait le premier film en Action Réelle à rendre hommage Et à solder toute l’œuvre créative du studio… justement, au moment où ce dernier a atteint une telle apogée que les spectateurs lui interdisent même de se réinventer, d’explorer d’autres voies encore plus personnelles et radicales, générant ainsi une incompréhension continue (et des tas de suites commerciales en conséquence, sensées rassurer à nouveau le public).
On a donc ici un mélange de « Toy Story », « Monstres et cie », « Là-haut », « Vice-versa »… C’est à dire une petite fille, son deuil, ses peurs, ses amis « invisibles » qui lui donnent de l’inspiration, boules d’angoisse (et souvent de poils), craignants d’être oubliés et de disparaître. Mignon, drôle, un conte avec de la morale pré-Adulte.
On y trouve même des points communs avec un autre film d’animation (de la Paramount, tiens donc !?), « Le Parc des Merveilles », qui mettait aussi en avant la maladie, et la création artistique/fictionnelle comme façon d’exorciser la peur de la Mort, de la perte de l’enfance…
Dites donc ça fait beaucoup tout ça ! Krasinski aurait-il écrit son film avec ChatGPT ?
Il n’est pas interdit de se poser la question devant un opus qui contient aussi de grands points communs avec (encore !) un autre film Disney, pas si éloigné de Pixar, mais pas animé celui-là : « À la poursuite de demain ».
Gamine pugnace, tâches de rousseur, vraie croyante face à un adulte désabusé et émotionnellement bloqué, ambiance Rétro, émule des « Voyages de Sullivan »… Comme avec Brad Bird, on a une histoire qui n’est pas faite pour être complètement divertissante, ni parler entièrement aux plus jeunes (il y a « Harvey » à la télé, ok… mais quels gosses connaissent cette histoire ? surtout en dehors des USA ?).
Même si traversé par un climax central (la visite virtuelle de Tomorrowland pour l’un, la reconfiguration d’un Foyer pour l’autre), l’émerveillement n’y est pas une donnée principale, ce qui compte le plus ce sont les moments en creux, au détriment du reste. Ce qui était plus problématique avec Bird, qui s’est cassé les dents sur le scénario de Damon Lindelof, plutôt porté sur les échecs formateurs (re-Pixar)… tout en besognant les instants SF super rocambolesques, lesquels en devenaient bien trop incompatibles avec le sujet.
Krasinski s’en sort un peu mieux parce que son film n’a pas d’action et de course-poursuites, qu’il reste une petite comédie dramatique assumée, même si sa propre utilisation de la musique de Michael Giacchino (re re-Pixar) ajoute trop de rythme et d’émotions intempestifs.
Film qui repose sur tellement d’évidences, dont Ryan Reynolds – l’acteur (lui aussi père de famille, devenu très prudent) a plusieurs obsessions : les buddy-movies débilitants, le body-swap, et les gugusses qui parlent dans le vide comme ici. Au moins il n’est pas entouré d’une flopée de personnages sortis de franchises connues, et il se met au service du script et de l’héroïne, que joue avec conviction la jeune Cailey Fleming… Non sans quelques lassitudes, qu’on peut mettre en parallèle du statut de l’acteur (marre d’avoir trop joué les rigolos insolents ?).
Quant aux vedettes qui sont invitées à donner de la voix aux amis imaginaires, c’est carrément la famille et les potes (de Krasinski, de Reynolds, ou bien autour de « Killing Eve »)… Ce qui renforce encore plus l’impression d’un film fait dans son coin, à l’économie, sans esbroufe.
Et qui prend une dimension imprévue quand on pense aux récentes grèves à Hollywood, lesquelles ont participé au décalage de la sortie du film : toutes ses stars venues se prendre au jeu (certaines étant des gags Reynoldsiens récurrents)… ne craignent-elles pas elles-mêmes de devenir comme ses créatures semblant vivre dans un hospice, attendant qu’on vienne les adopter, attendant d’apporter réconfort et inspiration à des spectateurs ? – qu’ils soient bien portants ou non (on pense évidemment aux clowns d’hôpitaux).
Et si eux-aussi devenaient obsolètes, bien avant l’heure ?
Peut-on alors parler de problématiques réelles sur les talents qu’on galvaude, avec un script qui contient lui-même beaucoup d’automatismes ? C’est un sacré paradoxe, d’autant plus renforcé par la VF qui, non contente de faire du recyclage (titre calqué sur « Monstres et cie », des stars comme José Garcia, Mylène Farmer ou Marina Foïs qui sont déjà passées par le doublage), traduit forcément les « Imaginary Friends » en « Amis Imaginaires ». Ce qui nous fait passer des initiales IF (« Si ») à AI… comme Artificial Intelligence.
Gaffe révélatrice ?
En attendant, le film remplit bien son « office », est suffisamment attachant et offre quelques jolis instants à la limite du tire-larme.
Et si ça aide Krasinski à moins avoir peur de l’avenir, tant mieux pour lui.