Bienvenue dans le bar de Galactus : chaque lundi, une nouvelle page est à votre disposition pour discuter cinéma, télévision et comics au sens large, loin des univers Marvel et DC Comics !
Grosse semaine en vue ! Mercredi, nous assisterons à la résurrection d’une franchise emblématique des années 2010 avec la sortie de Hunger Games : La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur, une préquelle qui se déroule 64 ans avant l’ascension du Geai Moqueur. Francis Lawrence est toujours derrière la caméra… avant de s’atteler à Constantine 2 ? Deux jours plus tard, Netflix proposera la série animée Scott Pilgrim Takes Off, adaptation ultra-fidèle des comics de Bryan Lee O’Malley avec en prime le retour du casting assemblé par Edgar Wright en 2010. Et pour ceux qui ont encore un petit creux, Apple TV+ lancera le même jour Monarch : Legacy of Monsters, une série en partie réalisée par Matt Shakman (WandaVision, Fantastic Four) et qui s’inscrit dans le MonsterVerse, histoire de patienter entre Godzilla vs. Kong et Godzilla x Kong : The New Empire. Tributs, ex maléfiques et kaiju… il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, à vos claviers et puisse le sort vous être favorable !
Le jeune Coriolanus est le dernier espoir de sa lignée, la famille Snow autrefois riche et fière est aujourd’hui tombée en disgrâce dans un Capitole d’après-guerre. À l’approche des 10ème Hunger Games, il est assigné à contrecœur à être le mentor de Lucy Gray Baird, Tribut originaire du District 12, le plus pauvre et le plus méprisé de Panem. Le charme de Lucy Gray ayant captivé le public, Snow y voit l’opportunité de changer son destin, et va s’allier à elle pour faire pencher le sort en leur faveur. Luttant contre ses instincts, déchiré entre le bien et le mal, Snow se lance dans une course contre la montre pour survivre et découvrir s’il deviendra finalement un oiseau chanteur ou un serpent.



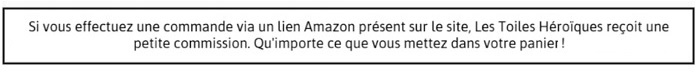



J’ai vu The Killer, le dernier film de Fincher sorti sur Netflix. J’ai trouvé ça long et fastidieux. J’ai l’impression que signer avec Netflix a aspiré son âme, déjà Mank c’était pas top.
Je n’ai pas vu Killers of The Flower Moon mais pour moi quand un gros real fait un film pour une plateforme c’est souvent un de ses pires voire son pire film. On verra pour le Snyder mais je ne suis pas serein. La liberté créative totale ainsi qu’un chèque en blanc ce n’est jamais bon.
the Killer
… avec Fassbender
KOTFM est absolument exceptionnel ! L’exception qui confirme la règle 😉
Arthdal Chronicles saison 2. Encore meilleur que la saison 1.
On se perd moins dans les points de vue. Et l’action est bien plus resserrée. Bref les défauts de rythme que certains ont pu relever ( mais qui ne m’avaient pas gêné) ont disparu.
Il me reste encore 2 épisodes. Et je dois dire que c’est vraiment enthousiasmant.
Pour la suite je vais me lancer dans Bionic Life, la série de SF chinoise. Et je prévois de jeter un œil à Tales of skyard sword, une série de fantasy thaïlandaise pour changer un peu.
Morbius : mon 1er film Venomverse ! Franchement y a de la volonté. Ça aurait pu passer… dans un film spiderman (l’univers amazing correspondrait le mieux), avec Morbius en vrai antagoniste…
Ça va trop vite et se termine trop brusquement. Quid de son envie de boire du vrai sang ? Et no comment de la scène post-crédit…
Et bon sang (sans jeux de mots) ! Qui a conçu ce système d’éclairage à détecteur de mouvement où tu te retrouves dans le noir pendant une seconde le temps que l’éclairage suivant s’allume ? Un fan des films de zombies ?
J’avais vraiment bien aimé l’honnête proposition qu’était Morbius. Et oui je suis d’accord que l’Amazing Spider-Man est le plus compatible des 3 versions avec lui.
Monarch, combien d’épisodes et quel rythme de diffusion ?
Quelqu’un sait ?
10 épisodes. 2 ce vendredi puis 1 épisode/semaine jusqu’au 12 janvier.
Les 2 BA m’ont bien donné envie. D’autant qu’à pôle fait des choses vraiment intéressantes. Pourtant pas vraiment adepte du monsterverse
Hunger games, j’avais trouvé que l’idée d’un prequel était inutile et donnait l’impression classique d’holywood de vouloir trop tirer sur la corde d’une franchise par manque d’inspiration. Le 1er trailer m’avait renforcé dans mon appréhension.
Mais le 2e trailer m’a beaucoup intrigué, notamment vis-à-vis de snow. Et cette phrase ( » c’est ceux que nous aimons le plus qui nous détruisent ») prend un tout autre sens avec cette histoire à priori. Donc pk pas, j’ attends les 1ers retours si ça vaut le coup d’aller en salle.
Les « Hunger Games » étaient surprenants, au dessus du lot tellement ils traitent de sujets pas uniquement adolescents (et très critiques, très durs).
Vous avez loupé le coche avec « Le Règne Animal » et « Second tour » de Dupontel…
Pensez à recommander aussi « Vincent doit mourir ». Il y a de la place pour autre chose que des opus de franchises ou de plateforme.
Vu :
– « L’évadé de l’enfer »…
Pour son tout dernier film de réalisateur, Archie Mayo livre un objet bizarre, qu’on croirait tiré d’un cartoon… Paul « Scarface » Muni en gangster brute épaisse, complètement idiot (on croirait voir John Cena, voire Dominic West en surrégime). Accompagné de l’inénarrable Claude Rains en Diable loser mais savoureux… Pour ce qui s’annonce comme un des premiers buddy movie du cinéma, duo entre un crétin catastrophique mais plus capable qu’on ne le croit (surtout pour les beaux yeux de Anne Baxter), et du stoïque qui n’a aucun contrôle sur son partenaire de circonstance. Zappant même toute velléités de rédemption angélique pour le truand damné, au profit d’une amitié improbable entre deux fripouilles rigolotes.
_
– « Le trésor de Monte-Cristo »…
Une série B bien moyenne par William Berke, qui ne traite son sujet que dans le dernier tiers – faut être sacrément patient !… Mais on a bien compris que c’est ça l’enjeu de l’histoire, liée au protagoniste principal (encore un faux coupable qui s’est fait enfumé par une presque femme fatale).
Sinon il y a un peu de romantisme bien sympathique…
_
– « Le Traquenard »…
Bien, un Richard Fleischer qui manquait. Un énième film policier à tendance documentaire à la gloire du professionnalisme de l’Institution (département du Trésor Américain ici).
Mais ce qui intéresse Fleischer, depuis ses études, c’est plus les criminels. D’où un plutôt charismatique Lloyd Bridges en tête d’affiche, alors qu’il y est un truand individualiste, trahissant très vite la Police au lieu de collaborer pour mieux s’en sortir.
Le film passe alors par une série de jeux de dupes assez parano, où tout le monde est susceptible de se trahir, même accidentellement.
Efficace, à défaut d’être complètement abouti.
_
– « Sables mouvants »…
Irving Pichel réalise plus un drame, un peu social, avec du crime dedans. Sur une jeune génération en perte d’espoir, enfermée malgré elle dans une spirale malchanceuse (l’argent mal gagné, les dettes qui s’accumulent).
Une lente descente aux enfers qui aurait peut-être pû être encore plus radicale, plus triste (façon Nicholas Ray, disons) si ce n’était pas Mickey Rooney dans le rôle principal ? L’un des enfants chéris d’Hollywood, ayant toujours son allure poupon, semble désamorcer les enjeux dramatiques finaux rien qu’en étant là, au profit d’un final (à suspense tout de même) ayant moins d’amertume que prévu.
À noter aussi la présence de Jeanne Cagney, tout son frère (James) mais en femme !
_
– « Dans l’ombre de San Francisco »…
Norman Foster réalise peut-être son meilleur film (pas bien compliqué), une histoire de témoin de meurtre (Ross Elliott), en fuite et… raconté depuis le point de vue de ceux qui le recherchent – un Robert Keith plus énergique qu’à l’habitude, un Denis O’Keefe très calculateur (pas de panique, on comprend très vite qui il est)…
Et la femme du témoin, jouée par une Ann Sheridan d’abord blasée puis culpabilisante à mesure qu’elle découvre les pensées profondes de son mari…
Car il s’agit aussi d’un film de remariage, mais pas une comédie non… Un bon film dramatique sur deux êtres qui se sont jadis aimés, et qui ont depuis oublié pour quoi, jusqu’à ce qu’ils aient enfin de franches et émouvantes conversations pour mettre les choses au clair. Et tout ça sans bâcler le suspense, qui atteint des sommets dans le final – montage alterné, impuissance et violence des montagnes russes de fête foraine, c’est splendide.
_
– « La Fracture »… Et la facture, salée. 🤧
Catherine Corsini fait une sorte de mini critique du mouvement Gilets jaunes avec du recul, mais au sein d’une des manifestations recréée pour l’occasion.
L’occasion d’une comédie à l’italienne où la réalisatrice se pastiche, via le personnage d’artiste petite bourgeoise à l’affection toxique, que joue Valeria Bruni Tedeschi… Forcément latine, forcément casse-pieds, c’est toute la proposition du film. Elle et son équivalent prolo que joue Pio Marmaï (avec la pince sans rire Marina Foïs coincée au milieu) sont ces « monstres ordinaires » pleins de mauvaise foi et incapables de trouver des solutions à leurs problèmes tellement la colère aveugle tout. Une sorte d’archétypes, symbolisant deux classes sociales ?
Mais en contenant l’histoire au sein d’un hôpital où des travailleurs, eux aussi mécontents, résistent tout en continuant quand-même à soigner et réparer plutôt qu’en cassant tout (avec la révélation de la très empathique Aissatou Diallo Sagna)… Sans compter le passage alentours de divers quidams moins cartoonesques, qu’ils soient patients (le segment autour du personnage que joue Camille Sansterre est bouleversant), accompagnants, policier…
On nous y rappelle donc (bien à propos puisque c’est contemporain des crises hospitalières récentes) qu’il n’y a pas qu’un seul type de point de vue dans cette grogne généralisée.
Et là, ça ne fait plus rire du tout… mais était-ce vraiment le but ?
Tel un « Grand embouteillage » de Comencini (mais avec beaucoup d’économie et un peu plus d’espoir), on n’est pas très loin du film pré apocalyptique.
_
– « Le Parc des merveilles »…
Voilà un film d’animation qui a bien digéré son Pixar et ses japonais…
Les réalisateurs Dylan Brown et David Feiss mettent en scène un évident ode à l’esprit créatif, sans nécessairement suivre les codes narratifs en vigueur. Ainsi la jeune héroïne est dès le début soutenue plutôt que restreinte, par des parents très compréhensifs malgré les dégâts qu’elle peut causer, ou le fait qu’elle ne soit pas plus concentrée sur ses études etc (beaucoup de personnages très intelligents dans ce film)…
Non c’est la petite June qui va de son propre chef suivre une voie plus sérieuse, plus (trop) adulte et plus conservatrice à cause du surgissement d’une maladie de sa mère. Jusqu’à ce qu’elle exorcise ses terreurs en vivant (ou en fantasmant ?) une aventure rocambolesque et reconstructrice dans le Parc d’attractions dit imaginaire qu’elle créa jadis avec sa maman, rempli d’animaux bizarres et hystériques.
C’est ce rythme assez épuisant, manquant de plus de temps morts, qui fait baisser la qualité de ce film, comme si la mise en scène façon Montagnes russes devait être le reflet de ce que ce Parc est censé promettre – c’est un peu moins faux cul que dans « À la poursuite de demain ».
Cela dit l’action est très satisfaisante, et la lumière est à tomber. Pas mal pour une petite production hispano américaine.
_
– « Broken City »… Et pieds. 😝
Allen Hughes (sans son frère Albert) échoue, comme bien d’autres, à faire ce que James Gray a pu réussir avec Mark Wahlberg : faire un bon polar new-yorkais « à l’ancienne », avec des patibulaires et un peu de politique, où les gagnants sont rares à la fin.
Plus que de s’inspirer des années 40 à 70-80, ce sont plutôt les 90’s qu’on sent poindre là dessous, reliquats réalisés souvent en mode automatique, contenant de grosses stars et quelques gueules qu’on aime bien, et sans grands succès. Surtout quand on a une galerie de personnages au langage ordurier et rétrograde, le personnage principal n’étant pas en reste – il est une brute insensible, qui va devoir réapprendre à être moins con, pas très loin d’un Mickey Rourke chez Cimino, mais sans la carrure appropriée.
L’occasion de profiter d’un Russel Crowe encore très en forme et athlétique, sinon tout ça est très basique et du déjà vu, n’offrant un peu d’intérêt qu’avec son combos d’acteurs.
_
– « Albert Nobbs »… Pas Nobel, pas Albert Londres, et puis on est à Dublin. 😉
Glenn Close revient à un personnage qu’elle a incarné à ses débuts d’actrice au théâtre, fonctionnant à l’opposé des rôles ultérieurs qui lui apporteront la renommée au cinéma… quoique, pas tant que ça.
Puisque ce mr Nobbs a beau être d’une sobriété maladive, il contient ainsi en lui la même tendance à l’exagération presque hystérique des rôles cultes de l’actrice chez Stephen Frears, Adrian Lyne etc…
Le réalisateur Rodrigo García s’acquitte de la tâche de transposer 30 ans plus tard cette pièce de théâtre en un film lent et doux, comme à son habitude – aux comédiens de faire le gros du boulot. Malheureusement l’intégralité du casting se contente de jouer une partition très usitée (tenancière obséquieuse, jeune fille un peu rebelle, jeune séducteur irresponsable)… Certain d’entre eux sont même là pour gonfler le casting de ce film indépendant en y apportant une touche irlandaise (Jonathan Rhys-Meyers ne fait que passer, Brendan Gleeson y est à peine développé), et on y entraperçoit même Phoebe Waller-Bridge et Emerald Fennell.
Mais de toute façon, on reste focalisé sur seulement deux actrices : Close donc. Et même très « close » puisque le cinéma se permet ce que le théâtre ne peut pas… faire des gros plans. En l’occurrence sur le visage de cire de ce personnage de femme traverstie dans l’Irlande victorienne, à la fois pour fuir un viol traumatisant et pour avoir un travail qui lui permette de mener une vie tranquille. Mais qu’on ne s’y trompe pas, ce n’est pas vraiment un Tootsie à l’envers puisque cette identité de Albert Nobbs n’est même pas un homme, selon les normes connues. Rien qu’un valet, au service de ses maîtres sans poser de questions, sans faire un quelconque étalage de virilité, tout discret (pratique dans un hôtel où passe la Haute Société). Et surtout un pantin, aux mouvements raidis par les gaines qui enserrent et affaiblissent son corps, à la face figée, de peur de montrer la moindre once de féminité – l’inverse alors d’un Buster Keaton des grands jours, celui dont le corps de pantin était vecteur d’action, et dont le visage impassible ne l’empêchait pas de séduire et se marier à la fin. Disons qu’on n’est pas loin du Keaton de « Boulevard du crépuscule »… c’est la même allure de Clown Blanc mais en mode tragi-comique et funèbre.
Un pathétisme chez ce « phénomène de foire » (dixit quelqu’un qui ne connait même pas son genre d’origine), qui menace le film de s’aligner sur le même ton s’il n’était pas régulièrement galvanisé par les apparitions de Janet McTeer, l’équivalent du clown Auguste. Travestie virile amusante qui symbolise tout ce que Nobbs a raté, notamment en s’interdisant d’aimer et d’être aimé, tout à ses projets de magasin de Tabac et de retraite dans 15 ans avec magot planqué sous les planches (dès qu’on voit tout ça, on sait que ça ne peut que mal finir).
Alors le personnage fascinant (mais de façon optimiste) de Hubert/McTeer, capable comme l’actrice d’exprimer aussi bien la masculinité la plus goguenarde et la féminité la plus voluptueuse, se voit comme une antithèse qui apporte une légère lueur d’espoir dans cette histoire plutôt amère.
_
– « Hannah »…
Le réalisateur Andrea Pallaoro nous raconte un instant qu’on ne voit jamais dans une histoire tournant autour d’un crime terrible… C’est à dire ni le crime lui-même, ni l’enquête, ni le retentissement médiatique ni même le point de vue des proches des victimes. Juste celui de la modeste femme du criminel, dont la vie est bouleversée alors qu’un mari qu’elle croyait connaître depuis 40 ans cachait un secret terrible (voire plus, si l’on se fit à la réaction de leur fils)… qui depuis vit sa routine dans l’angoisse du moment où tout va finir par publiquement se savoir, et qu’elle se retrouvera probablement seule contre tous, partageant ainsi une opprobre dont elle n’est pas vraiment responsable – sauf aux yeux de l’institution du mariage.
Femme fascinante jouée par Charlotte Rampling, Pallaoro allant exploiter ses caractéristiques bien connues à savoir ses regards, son corps, ses silences – c’est presque un film muet, reposant sur ce que les images racontent plus que les mots, cadrant au centre aussi bien la silhouette longiligne de l’actrice que des murs séparateurs. Puis, pour faire écho au prénom/titre en forme de palindrome, déconstruire tout ce qu’on connait par petites touches imprévisibles.
Un peu trop de coquetteries « intello » dans ce film (les répétitions de « La Maison de poupée » d’Ibsen, cet appartement bourgeois où elle vient ponctuellement faire ménage et baby-sitting, des performances artistiques à droite à gauche), et de séquences appuyant trop sur les sentiments intérieurs du personnage (tous ces petits enfants autour d’elle, la fille dans le métro qui explicite la colère due à la tromperie, cette baleine échouée qui donne un effet miroir).. .
Il en ressort surtout le portrait d’une belle femme du troisième âge, ayant grandement réussi à maintenir un tas d’activités qui lui sont personnellement enrichissantes (émotionnellement, physiquement), activités qui n’appartiennent qu’à elle…
Et à qui on risque de tout enlever pour la punir de son déni (qui n’est pas si absolu qu’on pourrait le croire), et mieux l’effacer du paysage, sans qu’elle n’ait la possibilité de – littéralement – se laver des fautes commises dans son giron.
Doit-on alors précipiter cette « mort » ? Ou juste se préparer amèrement à un dernier combat ? La toute dernière séquence du film vous donnera peut-être la réponse.
_
Lu :
– Troisième Intégrale des Tortues Ninjas d’origine…
Où on comprend bien que dans une pure œuvre de formalistes, invitant quelques auteurs indépendants pour marquer le coup – mais Michael Dooney est pourtant snobé de ce bouquin – ce qui compte c’est l’exercice de style plutôt que le développement des personnages.
Et de ce côté là il y a de quoi être déçu entre Splinter trop en retrait et même incapable de battre un simple survivaliste, April aux fourneaux et Casey en enquêteur foireux… C’est pas parce-qu’ils ont déjà eu quelques bons numéros centrés sur eux qu’il faut les négliger par la suite !
Il faut quand-même préciser que les auteurs Kevin Eastman et Peter Laird ne se supportaient plus (ils l’avouent eux-mêmes), travaillaient chacun de son côté, tout en étant très attentifs au développement médiatique d’une franchise plus Tout Public, plus épisodique… ce que le comic n’a pas envie d’être.
Alors après les quelques numéros se passant « au vert » à Northampton, l’arc du retour à New York et de la revanche (définitive) contre Shredder, ce seront juste trois volets d’action bien tassés, énervés, voire un peu faf (le guerrier Triceradon, deus ex machina mélangeant Rambo et un pauvre migrant perdu)… Bref du Frank Miller pour les amoureux de l’auteur.
Sec et visuellement brillant, garanti sans humour… Et sans humanité ?
_
– Suite de la deuxième Intégrale de Madman…
Encore de l’hommage à Frank Miller, avec un team-up entre la création de Mike Allred et Big Guy. Action conservatrice, plutôt plaisante.
_
– Fin de la dixième Intégrale de Invincible…
Incorrigible que ça devrait plutôt s’appeler. Pour une fois que Mark et Eve prennent le temps d’avoir une existence normale, faite de « petits riens » (transit intestinal notamment)… Il faut qu’on nous fasse ça sur une autre planète – légèrement décalée.
Ça tombe encore plus à plat car c’est entrecoupé par de la baston interminable dans un autre coin de la galaxie.
Malgré tous les efforts des auteurs, cette série flatte encore beaucoup trop les instincts bourrins des fans, pour les faire éviter de zapper.
Du Image comics des années 90 quoi…
Je viens de voir la bande-annonce de Yu Yu Hakusho.
Netflix a vraiment le mérite de vouloir sortir des adaptations de manga pour le meilleur et pour le pire.
J’arrive justement au bout d’un revisionnage de l’anime Yu Yu Hakusho et, si ce trailer cumule pas mal de red flags à mes yeux, je ne peux m’empêcher de trouver qu’il a de la gueule. Je trouve le casting raté et les producteurs ont l’air de s’être torchés avec le scénario, mais y a un petit quelque chose qui me donne envie là-dedans.
The Killer : comme son protagoniste : pro mais froid, clinique. Et chiant. Pourtant j’aime Fincher mais là….
Killers of the flower moon : 3h26 sans ennui, une photo sublime. Et la révèlation pour moi : Lily Gladstone, exceptionnelle. Scorscese et sa monteuse Thelma Schoonmaker (83 ans !!) ont toujours le sens du rythme.
Le régne animal : Original, fort, captivant. Encore une photo au top. Un cast au top aussi même si 1 perso ou 2 (bien joués cependant), paraissent inutiles.
Lessons in chemistry : Brie Larson sait tout faire. Voyez vous-mêmes.
« Hunger Games : La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur »… Baladins tristes.
Qu’est-ce qui fait qu’on a besoin d’un nouveau film de Hunger Games, alors que les 4 volets (nombre idéal pour une épopée suffisamment dense, saga pas abîmée par une floppée d’épisodes) ont déjà tout dit… et que tout ce qu’ils ne disaient pas, on pouvait l’extrapoler facilement ?
Et bien parce-que presque 10 ans plus tard, on voit que les choses n’ont pas évolué. Pire, que le monde semble se rapprocher de plus en plus de la dystopie créée par Suzanne Collins, qu’il y a encore des écarts entre riches et pauvres, et des conflits terribles qu’on arrive à contrôler par la peur, la propagande et le profit… jusqu’à banaliser la violence – l’accès facile aux vidéos d’attentats horribles, par exemple.
Oui, et on revient même à ce qu’était le film introductif de Gary Ross, un opus quasi autocontenu qui va plus reposer sur la description du fonctionnement de cette société à travers des jeunes gens, ainsi que la construction médiatique qui apporte le pouvoir aux plus ambitieux. Une époque où l’espoir était encore lointain.
Toujours cette obsession pour la mythologie gréco-romaine (avec ces noms impossibles, qui ressemblent à des virus), toujours le fidèle Francis Lawrence, toujours un mélange entre gros spectacle et économie, des salauds cartoonesques fringués comme des sapins de Noël (mention à la tenue « tampax usagé » de Viola Davis !), des décors d’après-guerre familiers… Avec des jeunes malléables et des apartés romantiques réglementaires (c’est du Young Adult), chastes et dépassionnées mais surtout à cause de l’urgence de la situation…
Beaucoup de contre-plongées dans la mise en scène, sûrement pour créer une sensation d’écrasement, et toujours un peu trop de didactismes naïfs – le côté « prequel à la Anakin Skywalker », lui, obéit à plusieurs codes très usités (les références qui déboulent de manière forcée).
Satire des émissions de divertissement, le personnage (Arieléen) de Lucy Gray Baird étant la coqueluche du public grâce à ses chansons, on est en plein télé-crochet – et un petit peu un rôle méta pour Rachel Zegler, confinée aux mêmes types de personnages…
D’ailleurs cette omniprésence musicale ne fait qu’appuyer le côté folk américain de la Saga, ou les légendes se créent aussi par des chants traditionnels, tournant souvent autour de la mort.
Critique du Hollywood du moment, aussi : dès le début on dit que tout le monde se détourne des divertissements, et que c’est avec des idées plus radicales qu’on peut les faire revenir, qu’importe les sacrifices. Une idée qui peut séduire une partie de la critique, blasée et passablement agacée par une bienveillance qui pourrait limiter l’imagination, les prises de risques.
Au moins le film nous rappelle à quel point ça peut être dégoûtant, révoltant, et qu’en fait on ne voudrait pas avoir envie d’être addict à ça.
On est bien surpris de voir que toute la partie autour des jeux à Panem ne concerne qu’un peu plus de la moitié du film… puis qu’ensuite l’histoire se délocalise dans un District (on passe d’une couleur dominante à une autre tout opposée), pour mieux raconter la façon dont notre protagoniste principal, par rejet, finira par assumer son ambition, envers et contre tous.
L’un des intérêts de cet opus étant aussi de prendre un parti pris inverse des précédents : au lieu de suivre de pauvres héros rebelles, on prend comme point de vue premier un Rastignac, déterminé à rendre sa gloire à sa lignée tout en essayant quand-même de sauver les fesses de son seul ami et de sa protégée.
Le fait que ça soit Coriolanus Snow (l’ambigu Tom Blythe) plutôt qu’un personnage équivalent qui serait moins prévisible, ce n’est pas trop grave. Ça permet de revoir l’intégralité de la Saga comme étant aussi l’histoire d’un homme coincé par son ascendance, incapable de devenir un héros et de savoir aimer.
Ainsi la romance naissante entre lui et Lucy sera vouée à l’échec (complété par une étonnante irruption du Surnaturel), comme l’anticipent à plusieures reprises ces scènes régulières où ils sont tous les deux présents à l’image dans le même gros plan, tout en étant séparés par un élément de décor qu’ils ne verront jamais.
Et seule comptera la loi du plus fort.
Pas du tout un film fait pour aller bien, pour oublier les problèmes extérieurs… Mais plutôt pour regarder bien en face de quoi l’avenir peut être fait, et quels sont les gens avides qui vont l’écrire.
« Snow thérapie »
https://www.comicsblog.fr/47137-Scott_Pilgrim_Takes_Off__Netflix_leache_une_petite_videeo_des_coulisses_du_doublage_pour_la_seerie_animeee
https://www.premiere.fr/Series/News-Series/La-saison-2-de-Monarch-Legacy-of-Monsters-est-enfin-commandee